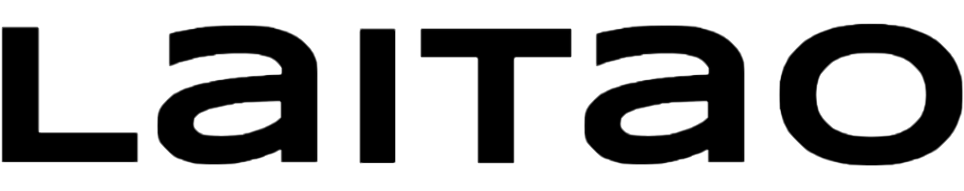IA : conversation désagréable sur une guerre civilisationnelle
Avec l'essor de l'IA, une vision technocratique où la rationalité algorithmique primerait sur la délibération se développe aux Etats-Unis. Le danger est grand pour des démocraties déjà affaiblies par les réseaux sociaux. L'Europe doit se réveiller.
Il y a désormais plus d'un quart de siècle que « Code is Law » a été énoncé par le constitutionnaliste Lawrence Lessig : l'idée est que la démocratie serait amenée à intégrer démocratiquement la présence d'algorithmes. Le contexte de l'époque, celui d'un Internet balbutiant et d'algorithmes encore rudimentaires, est si éloigné du nôtre qu'il est raisonnable de se demander s'il s'applique encore aujourd'hui.
En premier lieu, parce que ceux qui mènent désormais le débat sont les principaux opposants de son auteur d'alors, un démocrate convaincu. Des figures comme Peter Thielet les penseurs du mouvement LessWrong, bien que leurs motivations diffèrent, convergent souvent vers une vision technocratique où la rationalité algorithmique prime sur la délibération démocratique. Ils rêvent d'une gouvernance optimisée, dépouillée des lenteurs et des imperfections humaines, quitte à sacrifier l'aspiration de la majorité.
Lois auto-exécutables
L'idée de lois auto-exécutables, de votes instantanés et de décisions publiques optimisées par des algorithmes, popularisée notamment par les aspirations décentralisatrices des technologies blockchain (dont Satoshi Nakamoto fut le pionnier avec Bitcoin), est en outre ancienne. Elle promettait à première vue une efficacité accrue, une transparence radicale et une fin de l'arbitraire. Pourtant, cette vision est une méprise fondamentale sur la nature de la démocratie. Elle ignore que la concertation, inévitablement plus lente et parfois chaotique, est intrinsèque à son maintien. C'est dans le frottement des idées, la négociation des compromis et la reconnaissance des dissensus que réside la force d'une société démocratique, bien loin de la binarité implacable du code. La démocratie n'est pas une question d'efficacité, c'est un exercice d'inclusion.
S'il ne fait que peu de doute que les institutions publiques vont rapidement intégrer les algorithmes d'intelligence artificielle dans leurs processus de production, elles auront l'obligation de le faire dans un contexte démocratique, quitte à faire évoluer radicalement leurs institutions pour le permettre.
Or, la tendance va plutôt à la destruction programmée de la démocratie, comme l'observe depuis désormais quarante ans le chercheur Robert Putnam. Il remarque que lorsque Ronald Reagan arrive au pouvoir en 1980, les Américains ne disposaient que d'une poignée de chaîne de télévision (7 à 8 pour ceux qui n'avaient pas le câble, une vingtaine pour les autres). Mais lorsqu'il quitte son mandat en 1988, ce chiffre a explosé à plus d'une centaine. Dans le même temps, le temps d'écran moyen est passé de deux à plus de quatre heures.
Aujourd'hui, toutes formes d'écrans confondues, l'Américain moyen est à plus de sept heures. C'est autant de temps qu'il ne consacre plus à avoir des conversations avec ses voisins : les trois heures quotidiennes de « conversations désagréables » telles que les décrit Putnam. Aux cafés, places de village, services religieux, bowlings, supérettes, night-clubs, services publics… et autres lieux que la technologie a pour ainsi dire fait disparaître. Or, ces conversations désagréables sont le ferment de la démocratie : elles permettent de mieux comprendre ceux qui ne pensent pas comme nous et de créer un consensus politique beaucoup plus inclusif.
Le venin d'organisations humaines reposant sur des citoyens consommateurs largement frustrés par une hypnocratie technologique emporte peu à peu nos démocraties.
De leur côté, les réseaux sociaux ont bien compris que les propos outranciers, le clash… faisaient incomparablement plus de trafic sur leurs plateformes que les propos complexes et articulés. Les algorithmes à base d'IA sont avant tout utilisés pour les favoriser. Il existe donc une double force : celle de ceux qui ont largement porté Trump au pouvoir : les Thiel, Musk, Yarvin, Andreessen, qui ne voient aucun problème à la mise en place d'une technocratie nécessairement élitiste, et l'autre, celles des plateformes, dont les intérêts économiques sont directement en contradiction avec le fonctionnement démocratique.
Peur, colère et populisme
Il ne faut pas se faire d'illusion : les démocraties socio-libérales qui étaient l'objectif ultime de l'utopie des années 1990 sont toutes malades, partout dans le monde. Le venin d'organisations humaines reposant sur des citoyens consommateurs largement frustrés par une hypnocratie technologique emporte peu à peu nos démocraties : les mouvements populistes ne s'y trompent d'ailleurs pas, les utilisant pour induire tantôt la colère et tantôt la peur pour arriver, partout au pouvoir.
Le phénomène Trump n'est que l'aboutissement le plus spectaculaire de cette dynamique, et sans réaction, il en sera suivi par d'autres. L'incapacité de nos institutions nationales et plus encore européennes à susciter cette prise de conscience, en commençant par faire appliquer les lois nouvellement votées (le DSA/DMA et bientôt l'AI Act…), est confondante. Penser se concilier avec les Etats-Unis, alors même qu'il s'agit d'une guerre de principes civilisationnels, est une erreur qui se paiera cher.